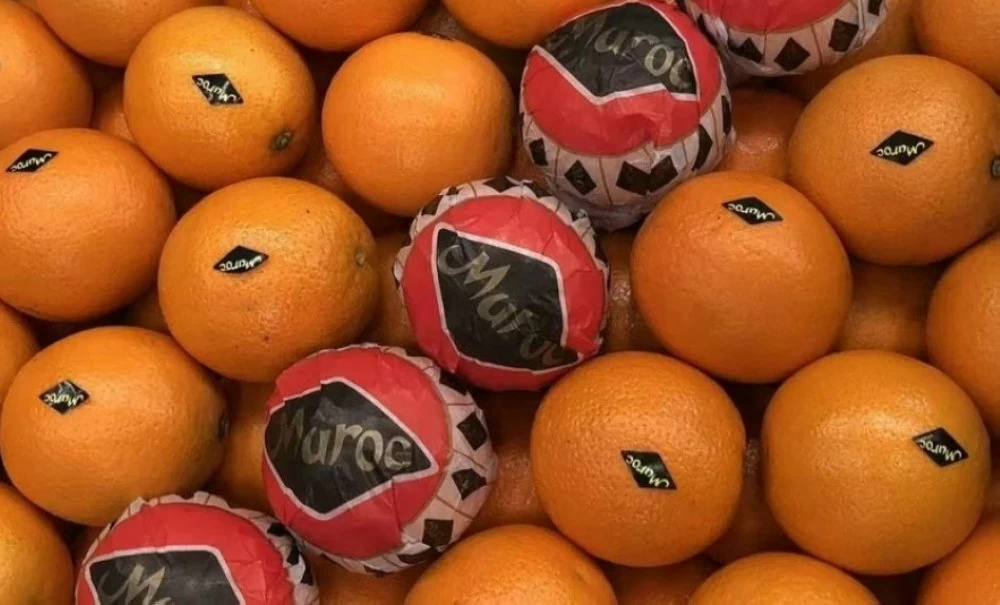En effet, entre 2021 et 2025, aucune baisse n’a ainsi été observée dans la région où 9.823 hectares sont cultivés en agrumes. Une stabilité qui pourrait indiquer, selon le patron de Maroc Citrus, une adaptation «réussie» aux nouveaux enjeux du secteur à travers la culture de la variété «Nadorcott». Bennani Smires rappelle qu’après l’engouement des années 2010-2016, porté par l’accès aux terres Sodea dans le cadre de partenariats public-privés ainsi que par la stratégie et les mesures d’accompagnement du Plan Maroc vert (PMV), la filière agrumicole s’était retrouvée face à une surproduction dépassant les capacités de conditionnement et de commercialisation.
Les superficies exploitées étaient ainsi passées de 98.000 ha en 2010 à plus de 128.000 ha en 2016 faisant grimper la production totale de la filière de 1,642 million de tonnes à 2,619 millions de tonnes. Mais si le secteur agrumicole a vu baisser drastiquement sa superficie exploitée et sa production reculer à 1,5 million de tonnes, le verger agrumicole marocain est jeune et équilibré en variété avec 50% du verger ayant moins de 15 ans et se caractérise par des produits de qualité avec une forte valeur ajoutée. Selon les données de Maroc Citrus, 48% des superficies agrumicoles actuelles ont été plantées dans le cadre du Plan Maroc Vert.
De même, 68% de ces superficies sont constitués de vergers de 5 à 20 ans et sont productifs. Les plantations les plus récentes (0-10 ans) représentent 22% du total, indiquant un renouvellement important du verger. Les vergers les plus anciens (plus de 40 ans), quant à eux, occupent encore 15% des superficies, avec un impact sur le rendement futur. En dépit de la crise où sombre la filière, le patron de Maroc Citrus entrevoit des opportunités que le pays gagnerait à explorer. «Nous avons un verger équilibré et rajeuni à 50% grâce aux investissements des dernières années. À cela s’ajoute la bonne évolution dans l’export des petits fruits. De même, la variété phare “Nadorcott” est à préserver, car elle n’occupe que 10% des superficies et 50% de l’export. Autre opportunité, le soutien de l’État pour l’export qui mobilise 1 dirham de subvention pour les expéditions d’agrumes vers l’Europe et l’Afrique (hors “Nadorcott”)», souligne Bennani Smires. De même, la profession entend saisir une autre opportunité qui se dessine à l’horizon suite à la baisse de la production des oranges à jus du Brésil et de la Floride (États-Unis). Mais comment le département de l’Agriculture appréhende-t-il la crise que traverse la filière ? Le secrétaire général de la tutelle, Redouane Arrach, qui intervenait lors du panel d’ouverture du Congrès, estime que la baisse des superficies agrumicoles peut-être compensée par une montée de la productivité. «Si l’on arrive à booster le rendement à l’hectare, cela permettra à la filière de retrouver son équilibre. D’où l’importance de donner un véritable coup de fouet à l’innovation et à la recherche.
L’enjeu est de renouveler les vergers en mettant au point de nouvelles variétés avec une faible empreinte hydrique et une production optimale. Depuis pratiquement 20 ans, aucune nouvelle variété n’a été développée», lance le responsable du ministère aux opérateurs de la filière. Arrach a tout de même regretté le fait que le secteur des agrumes ne bénéficie pas d’un soutien fort de l’État à l’instar de ce qui se fait dans des pays concurrents comme l’Égypte et la Turquie. «La filière des agrumes est ancrée dans l’histoire agricole du Royaume et doit à ce titre bénéficier d’un appui fort de l’État», fait-il remarquer. La filière fait vivre, en milieu rural, plus de 13.000 familles en créant 32 millions de journées de travail auxquelles s’ajoutent les nombreux emplois créés par les 50 stations de conditionnement et les 4 usines à jus.
La production nationale est estimée actuellement à plus de 1,5 million de tonnes dont les deux tiers alimentent le marché local tandis que le reste est exporté. Avec plus de 500.000 tonnes exportées, la filière contribue significativement aux rentrées des devises au pays et, partant, à la réduction du déficit commercial tout en assurant l’approvisionnement en quantité et qualité du marché local. Pour le secrétaire général de l’Agriculture, le renouvellement des vergers devra constituer l’un des axes centraux du plan de bataille de la filière. Car, à ses yeux, le Salut de la productivité viendra de là. Le patron du Crédit Agricole du Maroc (CAM), Mohammed Fikrat, qui était de la partie, partage le même raisonnement du secrétaire général de l’Agriculture. Selon lui, si la filière veut relever les défis liés au stress hydrique et au changement climatique, elle doit absolument électriser l’innovation et la recherche. «L’agrumiculture vaut son pesant d’or dans l’économie agricole du Royaume. Elle génère un chiffre d’affaires de 6 milliards de DH et compte parmi les filières les plus pourvoyeuses d’emplois. Pour pouvoir viabiliser ses performances, l’enjeu est de développer de nouvelles variétés résilientes au changement climatique. De même, un vent d’innovation est nécessaire dans les pratiques agricoles de la filière», explique Fikrate. Le président de directoire du CAM assure, par ailleurs, que son groupe a développé au cours des années toute une panoplie de produits adaptés aux différentes contraintes des filières agricoles notamment le financement des projets de rationalisation de l’irrigation en plus des facilités de trésoreries pour les agriculteurs.
Si les professionnels épousent ces orientations et confirment leurs engagements pour donner un véritable coup de fouet à l’innovation et à la recherche dans le secteur, ils demeurent tout de même inquiets face à la problématique de raréfaction des ressources hydriques. «Oui, nous sommes pour l’innovation et la recherche. Nous nous engageons pour le renouvellement des vergers. Mais l’eau d’irrigation est indisponible.
En dépit des dernières précipitations et leur impact sur le niveau de remplissage des barrages, nous observons une restriction des dotations dédiées à l’irrigation», s’alarme un producteur. Ces restrictions ont d’ailleurs été soulignées par Rachid Benali, président de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural. Lors de son intervention dans le congrès des agrumes, Benali ne mâche pas ses mots. «Le secteur agricole est en crise essentiellement à cause du stress hydrique. Avec le ministère de l’Agriculture, nous arrivons facilement à trouver des solutions pour des problématiques telles que l’inflation des intrants agricoles. Mais pour résoudre des complexités liées à l’accès à l’eau d’irrigation, la gouvernance chargée de la gestion de l’eau nous fait la sourde oreille. Et pourtant, nous sommes les premiers concernés quand il s’agit d’une montée des prix des produits agricoles sur le marché. On nous met la pression pour baisser les prix sans pour autant se donner la peine de connaître la série de problèmes que nous devons gérer quotidiennement sur les exploitations. Il est insensé de vouloir maintenir des prix bas des fruits et légumes sur le marché alors que nos coûts de production ont fortement monté», s’insurge le président de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comade).
La redoutable concurrence turque et égyptienne
Le stress hydrique n’est pas le seul défi pour la filière des agrumes. Confrontée à une vive concurrence à l’export, la filière, après l’entrée des produits égyptiens et turcs sur le marché russe, a dû, une nouvelle fois, se réinventer en allant à la conquête de nouveaux marchés. La forte baisse du marché russe a ainsi agi comme un levier de mise à niveau dans l’ensemble de la chaîne de valeur des agrumes marocains. Les opérateurs ont dû réorienter leur stratégie d’exportation vers des marchés plus exigeants en termes de qualité, de traçabilité et de certifications entraînant des avancées majeures notamment en montée en gamme et en généralisation des certifications.
Ces dernières, telles GlobalGAP (référence en matière de bonnes pratiques agricoles), SMETA (éthique et responsabilité sociale), GRASP (évaluation des pratiques sociales) ou encore LEAF (agriculture respectueuse de l’environnement) garantissent désormais non seulement l’accès aux marchés internationaux, notamment européens, mais servent également de gage de qualité auprès des distributeurs. Cette mise à niveau a également permis d’améliorer la qualité des produits offerts au marché local.
L’orange marocaine pressée à l’export
Également confrontée à une concurrence intense, notamment égyptienne, l’orange fait face à d’importantes barrières à l’exportation induisant une forte baisse qui impacte la filière avec notamment une saison d’exportation qui se trouve amputée de deux mois, nuisant à la rentabilité des stations de conditionnement, qui ne travaillent plus que cinq mois par an, et impactant directement les ouvriers des stations. Les usines de transformation pour le jus souffrent pour leur part du manque de matière première. Car ce sont les écarts de tri de l’export qui leur fournissent des oranges à bas prix. Les producteurs prolongent la saison jusqu’à la fin de l’été pour servir le marché local, en essayant de tirer profit des prix estivaux diminuant, du fait de la surexploitation, le rendement des arbres pour l’année suivante.
Annoncé récemment, le soutien de l’État, bien que bienvenu, reste insuffisant, aux yeux de Maroc Citrus, au vu de l’écart de prix de vente entre le Maroc et l’Égypte. Il constitue cependant un signal fort pour encourager les producteurs à exporter. La filière dispose néanmoins d’une opportunité pour regagner des parts de marché à l’export. En effet, le Brésil, plus grand producteur d’oranges au monde, a été touché par le virus du Greening et a perdu une partie de ses capacités de production. Cette baisse a fait grimper les prix du concentré d’orange dans le monde de manière impressionnante et a conduit les producteurs égyptiens à détourner une partie de leurs oranges de bouche vers les usines de transformation pour le jus, libérant une place potentielle pour les exportateurs marocains. «Malgré sa résilience et sa mise à niveau, la filière fait face à des défis majeurs qui, s’ils n’étaient adressés, pourraient compromettre la pérennité de l’activité à moyen terme», alerte Bennani Smires.
En premier lieu, le changement climatique, marqué par plusieurs années consécutives de sécheresse, frappe durement les zones agrumicoles à l’instar d’autres filières de l’agriculture nationale. Amené à durer, le déficit hydrique donne lieu à une incertitude intense pour les opérateurs de la filière et génère inquiétude et risques. «En dépit de l’ambitieuse stratégie menée autour de l’eau, la filière requiert aujourd’hui, le déploiement d’une approche spécifique pour sa sauvegarde et son développement, car il est probable, qu’avec l’assignation exclusive de la production issue du dessalement de l’eau de mer pour les besoins en eau potable, les ressources des barrages et les eaux recyclées qui seront allouées au secteur agricole seront probablement insuffisantes pour répondre aux besoins de l’agriculture», fait observer le patron de Maroc Citrus qui estime qu’il y a donc lieu aujourd’hui de se mobiliser collectivement, pouvoirs publics et professionnels, pour élaborer ensemble un plan destiné à assurer la sauvegarde de la filière et lui garantissant un accès durable à la ressource hydrique avec davantage de projets de dessalement et la mise en place d’«Autoroutes de l’eau». Aux yeux de Bennani Smires, ce défi est déterminant pour l’avenir de la filière agrumicole qui nécessite rapidement une étude approfondie et une concertation entre la profession et le gouvernement pour une mise en oeuvre dans les meilleurs délais.
La chaîne à structurer du verger au consommateur
Selon le constat de Maroc Citrus, la filière des agrumes est confrontée à certains dysfonctionnements organisationnels impactant l’efficacité et l’optimisation de la chaîne ainsi que sa compétitivité. Parmi les principaux problèmes identifiés, le morcellement excessif des terres agricoles, la faible organisation des producteurs et l’asymétrie de pouvoir de négociation avec les distributeurs qui génèrent une dépendance vis-à-vis des intermédiaires et allongent les circuits de commercialisation. Ce qui se traduit, selon la profession, par une augmentation des coûts pour les consommateurs finaux. De plus, le secteur souffre de pratiques spéculatives dans les marchés de gros, où une partie significative de la production n’est pas correctement valorisée, limitant ainsi la compétitivité sur les marchés internationaux. Pour l’interprofession, il est urgent de mettre à niveau l’organisation du secteur et d’améliorer sa structuration notamment en mutualisant les ressources pour renforcer le pouvoir de négociation et réduire les coûts de production.
La modernisation et le renforcement des infrastructures de transformation et de conditionnement ainsi que la chaîne du froid et le transport devraient également permettre d’éviter les importantes pertes post-récoltes tels qu’actuellement. Le secteur requiert, en outre, une réforme juridique pour moderniser les marchés de gros, faciliter l’accès direct aux marchés internationaux et réduire le nombre d’intermédiaires afin de limiter la spéculation et d’assurer un meilleur partage de la valeur ajoutée. Le fait est que la conjugaison des insuffisances en termes de logistique et de la multiplicité d’intermédiaires dans la chaîne de distribution pénalise non seulement les producteurs, mais impacte également fortement le consommateur en augmentant de manière conséquente le prix des produits et y limite l’accès pour le consommateur.
La main d’œuvre, une ressource qui se raréfie
En dépit du nombre important de familles en milieu rural qui tirent leurs revenus de la filière agrumicole, le secteur est de plus en plus confronté à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. «Fruit d’un arbitrage économique entre inscription à la sécurité sociale de manière saisonnière et revenu annuel continu dans le cadre du programme d’Aide sociale directe (ASD), de plus en plus d’ouvriers agricoles renoncent à l’exercice d’une activité déclarée créant ainsi une pénurie de plus en plus critique pour le devenir du secteur», explique Maroc Citrus.
À ce titre, et afin de pallier cette tendance pouvant compromettre le devenir de la filière et ses capacités de production, l’interprofession juge urgent de trouver un nouveau modèle collaboratif spécifique à cette catégorie de travailleurs dans le cadre d’une concertation entre le département de l’Agriculture et la Comader.
2025-05-13 17:07:00